Photo: Gordon E. Robertson.
Le droit à l’autodétermination du Québec a été âprement discuté dans les deux camps lors des épisodes référendaires de 1980 et 1995. Dans le camp fédéraliste, on doutait non seulement de la constitutionnalité d’une éventuelle sécession, mais également de la légalité sur le plan du droit international. Le camp souverainiste affirmait plutôt qu’étant une nation à part entière dans un pays culturellement différent, le Québec avait droit de choisir son avenir sans la tutelle d’une entité supérieure. Bref, deux positions difficilement réconciliables.
Le Québec a-t-il juridiquement droit de faire sécession du Canada? Que dit le droit international au sujet de la sécession? En regard du droit international, quelle position adopte le Gouvernement du Canada face à une éventuelle sécession du Québec? Ce sont ces questionnements qui guideront le présent exposé qui se veut une synthèse du droit en matière de sécession d’une part, ainsi qu’une tentative de compréhension de l’environnement juridique dans lequel une sécession du Québec pourrait s’opérer d’autre part.
Nous commencerons par clarifier le droit international en ce qui a trait aux questions relatives à la sécession d’un territoire, en examinant les bases de l’édifice juridique que s’est donné la communauté internationale par le biais de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Par la suite, nous explorerons l’encadrement juridique du Canada à propos de la possibilité de sécession par le Québec, pour finir avec les tentatives d’affirmation du droit à l’autodétermination québécoise.
1. Le droit international en matière de sécession
Conventions et accords internationaux sur le droit des peuples

Photo : ONU/Yould, 26 juin 1945
Lorsqu’on pense aux droits des peuples, on pense à la charte de l’ONU. Par contre, d’autres conventions ont été signées après 1945 (date de création de l’ONU) concernant l’autodétermination, et qui ont une portée plus exhaustive que la seule charte des Nations Unies. Notamment, les deux pièces maîtresses du droit international sont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La charte des Nations Unies
D’entrée de jeu, la Charte des Nations Unies ne reconnait pas explicitement le droit à l’autodétermination de tous les peuples, encore moins le droit de sécession. L’article 1 va comme suit : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d’égalité de droits des peuples et de leurs droits à disposer d’eux-mêmes […] » (ONU, 1945, article 1(2)). L’article 55 à propos de la coopération économique et sociale internationale abonde lui aussi dans ce sens.
Source : ONU, 1945
Le problème avec les droits des peuples, comme le souligne Rosalyn Higgins dans Secession and international law, est que le contexte semble arrimer les droits au peuple d’un État d’être protégé d’interférence par un autre État. Ainsi, les droits des peuples sont plutôt les droits des États que les droits des individus. Le concept d’autodétermination, à l’origine, ne référait pas au droit des peuples intraétatiques à devenir indépendant, mais aux États membres déjà constitués de poursuivre leurs aspirations librement (Dahlitz, 2003, p. 23). Pour preuve, le chapitre XI de la charte référant aux territoires non autonomes n’évoque toujours pas le droit à l’autodétermination. L’article 73(b) exhorte les États administrateurs de territoires non autonomes d’offrir aux populations « de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire […] » (ONU, 1945, article 73 (b)). Donc au lieu de laisser les peuples non autonomes se gérer complètement comme ils l’entendent, cet article semble plutôt justifier une mise sous tutelle décroissante, sans pour autant que l’indépendance formelle soit préconisée.
Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques
Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques ont tous les deux été adoptés à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966. Leur adoption marque une nouvelle étape dans le droit international concernant l’autodétermination des peuples. En effet, l’article 1 des deux conventions va comme suit : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » (ONU, 1966, article 1 (1)). À partir de ce moment, on voit le droit à l’autodétermination se cristalliser. Auparavant, il y eut une forte résistance au fait que le droit à l’autodétermination soit étendu au-delà du contexte colonial. En effet, la plupart des nouveaux États fraichement sortis de la colonisation étaient réticents à l’idée, car ils soutenaient que le principe était conforme à la décolonisation, afin de s’affranchir des anciens maîtres, mais qu’il ne l’était pas pour leurs propres populations parce que cela créerait des fragmentations au sein des États nouvellement formés (Dahlitz, 2003, p. 28).
Comme le note Antonio Cassese, l’autodétermination interne, c’est-à-dire décidée par le peuple du territoire concerné, doit être accomplie non seulement sans interférence externe, mais également interne. Ce qui veut dire que seul le peuple peut décider légitimement de son avenir et non pas les dirigeants. Il l’expose de cette façon:
L’autodétermination interne présuppose que tous les membres d’une population donnée soit autorisés à exercer les droits et libertés permettant l’expression de la volonté populaire. Ainsi, l’autodétermination interne est une manifestation de la totalité des droits contenus dans la Convention, plus particulièrement le droit à la liberté d’expression (Article 19); le droit aux assemblées pacifiques (Article 21); le droit à la liberté d’association (Article 22); le droit de vote (Article 25b); et, plus généralement, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, directement ou par des représentants dûment choisis. Seulement lorsque les individus se sont vus attribuer ces droits peut-il être affirmé que le peuple entier jouit de son droit à l’autodétermination interne.
— Antonio Cassese, 1995, p. 53. Traduction par R. Robitaille.
Cassese souligne tout de même certaines faiblesses concernant le Pacte relatif aux droits civils et politiques. En effet, soutient-il, ce document laisse trop de discrétion à l’État central. Selon lui, le modèle démocratique auquel le pacte fait référence est tellement général que les États peuvent trop facilement affirmer qu’ils respectent ces principes, sans pour autant offrir à toute la population du territoire de participer. À titre d’exemple, l’article 25, à propos du droit de participer aux affaires publiques et aux élections, est assez vague pour permettre un système de parti unique, ce qui, manifestement, brime les droits démocratiques inclus dans le Pacte (Cassese, 1995, p. 54).
Autodétermination et sécession : la pratique onusienne
Il est ardu de définir un cadre strict où il est possible de faire sécession pour accomplir le droit à l’autodétermination. Le problème réside dans la faiblesse du droit international à cet égard tel que souligné dans Secession : International law perspectives : « Dans le monde postcolonial, le droit international n’autorise pas la sécession, mais il ne la prohibe pas non plus. Une lacune consciente existe dans ce domaine, faisant de la sécession beaucoup plus une question de fait et de force que de droit » (Kohen, 2006, p. 142). Aucun droit de sécession n’est explicitement reconnu dans les textes de droit international concernant les minorités ou les populations autochtones. De plus, les conventions interétatiques et internationales ont, la plupart du temps, une clause empêchant le recours à la sécession, hormis dans un contexte colonial. En même temps, puisque le droit international est conçu par les États eux-mêmes, il ne faut pas s’étonner qu’ils ne reconnaissent pas le droit à leurs composantes de les « démembrer » (Kohen, 2006, p. 142). Le concept d’intégrité territoriale cher à l’ONU représente une autre facette au fait que l’organisation reste muette sur le droit de sécession en dehors des situations de décolonisation, car coupler sécession et intégrité territoriale peut engendrer d’autres problèmes. Par exemple, on se souviendra de la situation de Gibraltar, qui a amené le Royaume-Uni à se porter comme grand défenseur de l’autodétermination pour contrer les assertions de l’Espagne concernant le fait qu’elle possédait ce territoire avant les Britanniques (Dahlitz, 2003, p. 112-113).
Source : Andrei nacu, Wikipedia, 2008
Malgré le fait qu’il n’y ait pas de provisions explicites quant au droit de sécession, l’ONU et ses membres ont tout de même toléré des séparations. Examinons les différents critères qui ont permis de conduire des activités sécessionnistes en dehors des situations de décolonisation.
Les principes en matière de décolonisation
Avant 1960, l’ONU était moins stricte en ce qui concerne l’aboutissement du droit à l’autodétermination pour les peuples coloniaux. N’insistant pas sur une accession à l’indépendance complète plus que sur les autres formes d’autodétermination (conservation de liens avec la métropole, rattachement à un autre État, etc.), l’ONU a en quelque sorte changé d’attitude après 1960 en priorisant une accession à l’indépendance. Après la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l’indépendance de ces régions a été présentée comme la seule sortie possible face à la colonisation (Christakis, 1999, p. 48). Bien entendu, ceci a donné des munitions aux partisans du droit de sécession pour les peuples non coloniaux, car l’attitude de l’ONU semble favoriser les peuples colonisés en ce qui a trait au droit de sécession. En somme, comme l’affirme Marie-Claude Smouts (Smouts, 1972, p. 846) : « l’autodétermination est admise à l’intérieur d’une colonie, elle est condamnée à l’intérieur d’un État devenu indépendant ».
Extension aux peuples non coloniaux : la position de l’ONU
La jurisprudence internationale a officiellement refusé de reconnaitre un droit de sécession aux groupes infraétatiques. On soutenait qu’accorder ce droit aux minorités aurait fait vaciller l’ordre et la stabilité au sein des États, et aurait créé l’anarchie sur le plan international (Dahlitz, 2003, p. 65). Mais l’ONU elle-même ne s’est jamais positionnée sans équivoque sur la question de la sécession. Le sujet est trop complexe pour que l’organisation se positionne de façon définitive, c’est pourquoi, selon John Dugard, elle préfère maintenir un niveau d’ambiguïté. Il est clair que l’ONU ne considère pas la sécession illégale, pour preuve, elle a accordé plus d’une fois le statut de membre à des États ayant mené à bien leur projet sécessionniste, tels que le Bangladesh, l’Érythrée, et les anciens États yougoslaves (Dahlitz, 2003, p. 91).
Mais outre le fait que la sécession ne soit pas considérée comme illégale, elle n’est toujours pas reconnue en tant que droit. C’est pourquoi les tenants de l’extension de la pratique coloniale en matière de sécession se basent généralement sur deux arguments, chacun arrivant au même résultat afin de la faire reconnaitre. Le premier : la notion d’autodétermination doit être élargie pour y inclure les autres peuples. Le second : étendre la notion de peuples colonisés pour que tous puissent bénéficier du droit à l’autodétermination (Christakis, 1999, p. 48).
Le premier argument prend source dans les doubles standards du droit international. Effectivement, le droit international accorde des droits maximalistes aux peuples sous domination coloniale, à savoir une autodétermination complète aboutissant à un État souverain, mais nie de tels droits aux autres peuples. Les partisans de cette théorie affirment qu’ « il n’existe aucune raison, ni justification morale, pour faire une distinction entre le colonialisme ʺclassiqueʺ et d’autres formes de domination, d’exploitation économique ou de discrimination culturelle » (Christakis, 1999, p. 49).
Le deuxième argument, lui, prend source dans la pratique. Nombre de mouvements sécessionnistes se proclament peuples colonisés afin de montrer qu’ils ont bien un droit complet à l’autodétermination. Bien entendu, ceci est subjectif. Il est évident qu’un peuple souhaitant faire sécession tend à voir l’État central comme un colonisateur. Le problème est que cela peut facilement déraper vers des utilisations abusives de la notion de colonisation (Christakis, 1999, p. 50-52).
Le principe de l’effectivité
Le principe d’effectivité est un concept développé par les juristes en réponse aux lacunes du droit international. La théorie de l’effectivité « ne fait que constater la faiblesse du droit en matière de sécession, et met l’accent sur la force des faits et sur la réunion cumulative des éléments constitutifs de l’État » (Christakis, 1999, p. 74). En d’autres mots, le principe d’effectivité veut que la création d’un État relève du fait avant du droit. Donc, toute entité infraétatique peut tenter de faire sécession et d’instaurer une nouvelle effectivité, autrement dit, réunir tous les éléments constituant un État. Une fois le fait accompli, le droit international entérine la nouvelle constitution étatique sans remettre en cause la formation de cet État. Selon cette théorie, la création de l’État est un fait primaire, c’est-à-dire qu’il précède le droit. Le droit n’a donc pas juridiction pour refuser la création de l’État (Kohen, 2006, p. 139).
Bref, la théorie de l’effectivité répond à une zone de non-droit, puisque le droit international reste muet à propos de la sécession. Le test de l’effectivité permet de prendre acte du moment où l’entité sécessionniste a atteint les éléments constitutifs nécessaires à un État, remplissant ainsi les conditions permettant au droit de reconnaitre cet État. Celles-ci étant : une population occupant un territoire donné et pourvue d’un gouvernement souverain (Kohen, 2006, p. 143). Seulement lorsque ces conditions sont remplies y a-t-il possibilité de reconnaissance internationale.
2. Encadrement juridique canadien sur la sécession du Québec
Maintenant que nous avons exploré ce que le droit international avait à dire sur l’autodétermination et la sécession, il convient de plonger dans le droit canadien. Comme il a été mentionné plus haut, le droit international reste très vague, parfois même contradictoire lorsqu’il s’agit d’autodétermination, allant jusqu’à accorder les pleins droits aux peuples coloniaux, mais pas aux autres. Lorsqu’on parle de sécession, il n’est nulle part écrit noir sur blanc que l’ONU l’accepte, mais l’organisation ne semble pas la prohiber non plus. Face aux ambiguïtés toujours persistantes au regard du droit international, voyons ce que le droit canadien réserve à une province sécessionniste.
La Cour Suprême et le Renvoi sur la sécession du Québec
Peu avant le référendum de 1995, le gouvernement fédéral du Canada s’est adressé à la Cour Suprême du Canada en vue d’en défier la tenue. Un premier jugement a été rendu quelques semaines avant le référendum et en 1998 fut publié le Renvoi sur la sécession du Québec. Dans ce renvoi comportait une exigence de clarté à l’égard de la question référendaire. Peu après, le Parlement canadien vota la Loi sur la clarté référendaire, qui venait dorénavant baliser l’autodétermination du Québec et son droit, du moins soutenus par les souverainistes, de faire sécession.
Le contexte

Photo : André Querry, 27 octobre 1995
À la suite du référendum de 1995, la mince victoire du Non a amené un changement d’attitude dans le camp fédéraliste et surtout à Ottawa. On développe un plan, aussi connu sous le nom de “plan B”, afin de contrecarrer les projets indépendantistes du Québec. Ottawa demande donc à la Cour Suprême un jugement sur la possibilité de sécession par une province (Dahlitz, 2003, p. 168; Kohen, 2006, p. 422). Trois questions sont alors posées :
- L’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
- L’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
- Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? (Cour Suprême du Canada, 1998, p. 218)
La Cour a refusé de répondre définitivement par oui ou par non dans son Renvoi sur la sécession du Québec. Plutôt que de nier le droit de déclarer son indépendance au Québec, la Cour soutient que dans l’éventualité d’une déclaration unilatérale du Québec, toutes les parties concernées doivent se rendre à la table de négociation, sans quoi le Québec pourrait se tourner vers la communauté internationale (Dahlitz, 2003, p. 170).
Le contenu
Examinons, maintenant, les réponses de la Cour à chacune des questions présentées.
À la première question, la Cour soutient que, puisque le Canada est un État guidé par les principes démocratiques, fédéralistes, constitutionnalistes et relié par des liens d’interdépendance, une décision démocratique du Québec en faveur de la sécession pourrait mettre en péril ces liens. La Cour affirme : « La Constitution assure l’ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d’une province ne peut être réalisée unilatéralement ʺen vertu de la Constitutionʺ, c’est-à-dire sans négociations, fondées sur des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant » (Cour Suprême du Canada, 1998, p. 220). Au désarroi d’Ottawa, la Cour n’a pas réfuté le droit de sécession du Québec. On pourrait même dire qu’elle a entériné ce droit, à condition que le processus soit fait selon des normes démocratiques.
À la deuxième question, concernant le droit international, la Cour soutient que « même s’il n’existe pas de droit de sécession unilatéral en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n’écarte pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle conduisant à une sécession de facto » (Cour Suprême du Canada, 1998, p. 222-223). Cela rejoint ce qui a été dit précédemment, à savoir que le droit international ne donne pas le droit de sécession, mais ne le prohibe pas non plus. La Cour poursuit en soutenant que le succès d’une telle sécession (le cas échéant, unilatérale) dépendrait de la reconnaissance de la communauté internationale et de l’analyse qu’elle en ferait à propos de la légalité et de la légitimité (Cour Suprême du Canada, 1998, p. 223).
À la troisième question, qui demandait quel système juridique prévaudrait en cas de conflit entre le droit canadien et international, la Cour a conclu qu’il n’existait tout simplement pas de conflit.
La Loi sur la clarté référendaire et ses effets sur l’autodétermination du Québec
Peu de temps après le Renvoi de la Cour Suprême, le Parlement canadien a adopté une loi qui a été fort contestée par les souverainistes : la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, aussi connue sous le nom de Loi sur la clarté référendaire. Ses implications sont non négligeables pour l’autodétermination québécoise. En effet, puisque la Cour a réitéré l’obligation des parties concernées de négocier dans l’éventualité d’une sécession du Québec et a formulé une exigence de clarté, le gouvernement du Canada s’est empressé de déposer un projet de loi venant définir les termes de la liberté du Québec à choisir son avenir.
Le projet de loi a deux implications majeures pour l’autodétermination québécoise. Dorénavant, c’est la Chambre des Communes qui devra décider si la question présentée aux Québécois lors d’un référendum est suffisamment compréhensible (PL C-20, 2000, p. 2). Puis, c’est également la Chambre des Communes qui décidera, dans l’éventualité où un référendum serait tenu et remporté par les souverainistes, s’il y a une majorité assez claire de la population qui désire faire sécession (PL C-20, 2000, p. 4). Si la Chambre juge que la majorité n’est pas suffisante, elle refusera de négocier.
Pour Daniel Turp, la Loi sur la clarté « vise essentiellement à permettre au Gouvernement canadien d’être en mesure de définir la formulation de la question d’un futur référendum sur la souveraineté du Québec et de déterminer le seuil de majorité qui lui permettrait de se dérober de son obligation de négocier. » (Dahlitz, 2003, p. 172. Traduction de R. Robitaille). Évidemment, cette loi a provoqué un tollé au Québec. Elle a été perçue par le gouvernement québécois comme un acte illégitime du gouvernement fédéral pour bloquer un éventuel référendum et priver l’Assemblée nationale de ses pouvoirs (Kohen, 2006, p. 448). À propos de la majorité claire, Stéphane Courtois souligne que la fixation d’un seuil au-dessus de la majorité absolue (50% + 1), relève purement de l’arbitraire. On ne peut quantifier un seuil de légitimité démocratique en le mesurant en termes de stabilité politique (Courtois, 2000).
Ce n’est que peu de temps après la sanction du projet de Loi sur la clarté que l’Assemblée nationale du Québec a rétorqué en votant la Loi sur les droits fondamentaux du Québec.
3. Affirmation du droit à l’autodétermination du Québec
La Loi sur les droits fondamentaux du Québec : une réponse à la Loi sur la clarté
Afin de réaffirmer ses droits de poursuivre librement sa destinée et en réponse à la Loi sur la clarté, l’Assemblée nationale a adopté, le 7 décembre 1999, la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec. Cette loi a reçu l’appui du Parti Québécois et de l’Action démocratique du Québec, mais pas celui du Parti Libéral malgré un effort pour atteindre un consensus (Dahlitz, 2003, p. 175). Cette loi semble une réponse directe à la Loi sur la clarté du gouvernement fédéral en ce qu’elle révoque plusieurs dispositions prises dans cette dernière. Notamment, l’article 1 réaffirme les droits des peuples, l’article 4 la règle de majorité absolue et l’article 13 la primauté de l’Assemblée nationale dans la représentation du peuple québécois (PL 99, 2000, p. 4-6).
Le Québec en tant que nation distincte
Bien avant la Confédération, la spécificité du Québec a toujours, selon des degrés variables, été reconnue. On peut se rappeler l’Acte de Québec de 1774, qui offrait aux Québécois le loisir de pratiquer leur religion, de parler leur langue et de vivre selon leurs coutumes. Plus près de nous, en 1995, Jean Chrétien, alors Premier Ministre du Canada, a proposé une motion à la Chambre des Communes reconnaissant la spécificité du Québec. Cette motion comprenait que le Québec forme une société distincte avec une langue, une culture et des traditions propres (O’Neal, 1995, p. 22).
En 2006, le gouvernement de Stephen Harper a officiellement reconnu le Québec comme une nation au sein d’un Canada uni. Même s’il s’agit d’un bon pas pour la reconnaissance du Québec, le gouvernement a fait savoir qu’il n’y avait aucune conséquence juridique à une telle action, autrement dit, cela n’occasionne donc pas de modifications constitutionnelles (Dutrisac, 2006). Enfin, le terme « Canada uni » montre bien la volonté du Gouvernement canadien de préserver l’ordre constitutionnel existant et de ne pas céder en ce qui a trait à la sécession du Québec.
Conclusion
Après avoir déterminé la position du droit international à l’égard de l’autodétermination et de la sécession, puis l’encadrement juridique canadien à ce propos, quelques observations peuvent être faites.
Le droit international semble opérer deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit d’autodétermination. Les peuples coloniaux ont des droits maximalistes, alors que les peuples non coloniaux n’ont pas un droit complet à l’autodétermination, au sens où il peut aboutir à un État indépendant et souverain. Bien que non interdite, la sécession ne fait pas partie des droits offerts aux peuples, car une telle acceptation entrerait en contradiction avec les autres principes de l’ONU, comme l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières des États membres. Nous avons vu que pour remédier aux lacunes en droit international, les juristes ont développé la théorie de l’effectivité, voulant que la création d’un État relève du fait avant du droit, et qu’ainsi le droit est impuissant face à la création d’un État et doit se contenter d’entériner une sécession fructueuse.
La Cour Suprême, dans le Renvoi sur la sécession du Québec, semble confirmer nos appréhensions, à savoir que le Québec ne peut proclamer unilatéralement sa sécession sans au préalable négocier les termes de cette sécession avec les parties concernées, sans quoi il entrerait en contradiction avec la Constitution du Canada. On a également vu que le gouvernement fédéral a tenté de museler l’autodétermination québécoise en passant une loi venant la baliser selon ses termes. Il est clair que cette loi rendra la tâche des indépendantistes plus ardue, puisque les conditions sont imposées par l’État central, qui n’a aucun intérêt à laisser partir plus de 20% de sa population et autant de richesse.
À la lumière de ceci, on ne peut affirmer hors de tout doute que le Québec à un droit reconnu de sécession. Il en tient principalement à la communauté internationale de se prononcer en faveur ou non de la reconnaissance dans l’éventualité où une sécession fructueuse aboutit. Ce qui est certain jusqu’à présent, c’est l’absence de normes claires quant aux droits à l’autodétermination et à la sécession. Enfin, le droit n’est pas statique, il évolue selon les époques et les événements, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent. Une mince couche d’ambiguïté subsiste dans le droit justement pour permettre une certaine flexibilité dans l’appréhension des faits. Peut-être que, dans 20 ans, la situation juridique sera assez différente, qu’un tel effort pourrait être repris et obtenir des résultats différents.
Bibliographie
CHRISTAKIS1↑2↑3↑4↑5↑, Théodore. Le droit à l’autodétermination en dehors des situations de décolonisation, Paris, La Documentation Française, 1999, 676 p.
CASSESE1↑2↑, Antonio. Self-determination of peoples: A legal reappraisal, Cambridge, Cambridge University press, 1995, 375 p.
COUR SUPRÊME DU CANADA1↑2↑3↑4↑. Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 RCS 217 [en ligne], 20 août 1998.
COURTOIS↑, Stéphane. « Entre légitimité et stabilité : le débat sur la majorité requise dans l’éventualité d’un troisième référendum ». Argument [en ligne], vol. 2, no. 2, printemps-été 2000.
DAHLITZ1↑2↑3↑4↑5↑6↑7↑8↑9↑, Julie. (sous la dir. de) Secession and international law: Conflict avoidance – regional appraisals, La Haye (P-B), T.M.C. Asser Press, 2003, 283 p.
DUTRISAC↑, Robert. « Le Québec reconnu comme nation – Une motion sans conséquence, avoue Ottawa », Le Devoir [en ligne], 24 novembre 2006.
KOHEN1↑2↑3↑4↑5↑6↑, Marcelo G. (sous la dir. de) Secession : International law perspectives, Cambridge, Cambridge University press, 2006, 510 p.
O’NEAL↑, Brian. « La société distincte : origine, interprétation, implications », Division des affaires politiques et sociales, Bibliothèque du Parlement, 1995, 25 p.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES1↑2↑. Charte des Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale, 26 juin 1945 [en ligne].
ORGANISATION DES NATIONS UNIES↑. Pacte relatif aux droits civils et politiques, Assemblée générale de l’ONU, résolution 2200 A, 16 décembre 1966.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES. Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée générale de l’ONU, résolution 2200 A, 16 décembre 1966.
PL C-201↑2↑. Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, 2e sess, 36e parl, 2000.
PL 99↑. Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, 1e sess, 36e lég, 2000.
SMOUTS↑, Marie-Claude. « Décolonisation et sécession : double morale à l’ONU? », Revue française de science politique, vol. 22, no. 4, 1972, p. 832-846.
TURP↑, Daniel. « Le droit à l’autodétermination du Québec et le processus d’accession à la souveraineté » dans; Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, vol. 1, p. 655-686.




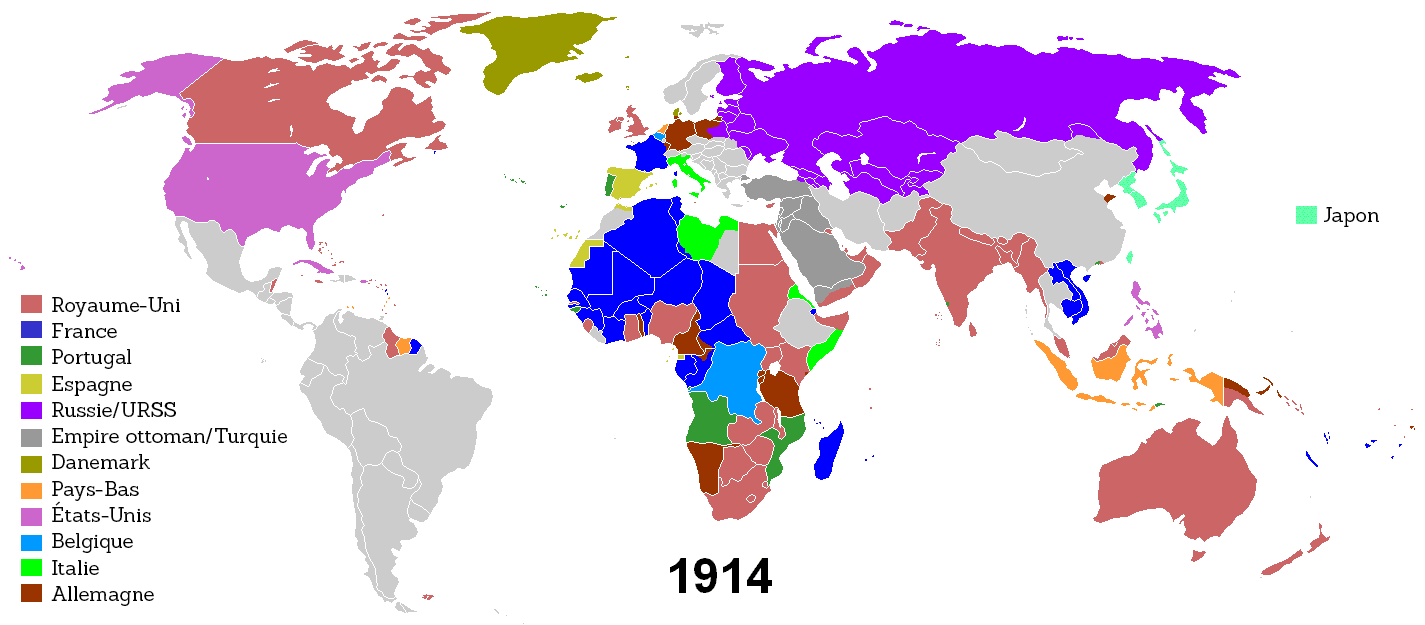
Publier un commentaire